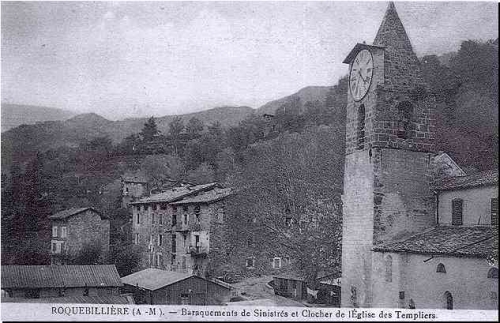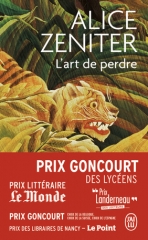« Je n’en ferai pas le récit chronologique. Les souvenirs sont ennuyeux, et les enfants ne connaissent pas la chronologie. Les jours pour eux s’ajoutent aux jours, non pas pour construire une histoire mais pour s’agrandir, occuper l’espace, se multiplier, se fracturer, résonner. » Ces mots au début de Chanson bretonne, de J.M.G. Le Clézio (suivi de L’enfant et la guerre, sous-titré Deux contes), donnent bien le ton de ces récits qui refluent vers la source de l’enfance. Il raconte, il se raconte.

L’écrivain dit avoir grandi avec l’idée qu’ils étaient des Bretons – « et qu’aussi loin que nous puissions remonter nous étions reliés par ce fil invisible et solide à ce pays ». Après avoir évoqué son père dans L’Africain, sa mère dans Ritournelle de la faim, c’est sur sa propre expérience qu’il revient ici. D’abord en retournant à Sainte-Marine, le village breton où ils se rendaient en famille chaque été, quand il était enfant (ils habitaient Nice).
Le pont de Cornouaille, en plus d’avoir fait disparaître le bac qui emmenait en dix minutes de l’autre côté de la rivière, à Benodet, a « rapetissé le paysage ». Dans le village de son enfance, une « longue rue de terre graveleuse » conduisait à la pointe et aux maisons bretonnes, la plupart « si pauvres et si anciennes », et aux villas des « Parisiens » avec leurs grands parcs, « arrogantes et prétentieuses ». Un seul commerce à l’époque, où on vendait de tout. Une seule source d’eau potable, la pompe communale, à bras – on y envoyait les enfants chercher de l’eau, deux fois par jour.
Les enfants du village se moquaient de son frère et lui, qui venaient d’ailleurs, « mais somme toute plutôt moins moqués que nous ne l’étions dans le Sud, peut-être parce que malgré tout nous leur ressemblions, et que nous étions capables de rétorquer quelques mots dans leur langue. » Beaucoup de mots bretons émaillent le texte de Le Clézio, qui n’en revient pas de la dizaine d’années qui ont suffi pour que « la musique de la langue bretonne » cesse de résonner.
La fermière chez qui ils allaient chercher le lait – « Elle parlait cette langue chantante du pays bigouden » –, les chemins creux entre champs et bosquets, la fête de la mi-août au château du Cosquer (dont la photo figure au début du récit), la moisson, les nuits d’été… Le Clézio ouvre en quelques pages des fenêtres sur son enfance en Bretagne, comparant les choses d’alors et celles d’à présent, remontant le temps « non comme une confession ou un album de souvenirs, mais comme une chanson bretonne, un peu entêtée et monotone […]. »
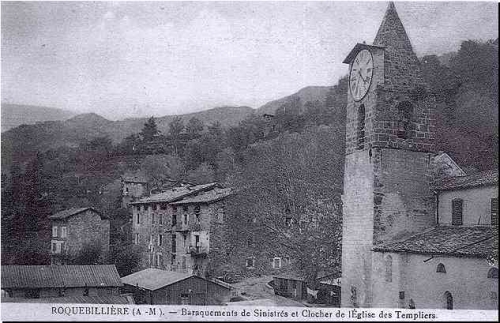
L’enfant et la guerre remonte à une autre source et dans un autre village, Roquebillière (Alpes-Maritimes). (Il vient d’être dévasté par la tempête Alex. Pour moi qui n’y suis jamais allée, ce nom restera lié à cette petite maison emportée par la crue sauvage de la Vésubie, où un couple de vieilles personnes a péri.) Au début du second récit de Le Clézio, on voit cette photo ancienne du clocher de l’église des Templiers et des baraquements des sinistrés (de 1926 ?).
Né à Nice le 13 avril 1940, l’écrivain qui a vécu ses cinq premières années dans la guerre n’en a que « des sentiments, des sensations, ce flux mouvant qui porte un enfant entre le jour de sa naissance et le tout début de la mémoire consciente, à l’âge de cinq ou six ans. » Tout ce qui arrivait lui paraissait « normal », l’interdiction de sortir, de regarder par la fenêtre, le fait de rester « à l’abri ».
Il se souvient de l’explosion d’une bombe dans le jardin de l’immeuble où vivait sa grand-mère à Nice, alors qu’il était dans la salle de bains de l’appartement au sixième étage, et d’avoir poussé un cri « strident ». Toutes les vitres du quartier avaient été soufflées, la bombe pesait 277 kilos – à présent, note-t-il, les bombardements lâchent sur les civils des bombes de 2000 kilos. Ses grands-parents avaient quitté Paris où ils avaient tout perdu juste avant la guerre pour s’installer au soleil, près de la mer, dans une ville où les loyers étaient restés bas.
Dans la zone dite « libre », eux qui ne sont ni juifs, ni riches, ont le tort d’être citoyens britanniques – « la nation que les Allemands détestent le plus ». Aussi vont-ils se réfugier à Roquebillière dont les habitants, comme ceux de Saint-Martin, se montrent généreux envers les fugitifs, quels qu’ils soient. Le Clézio a grandi là au milieu des femmes, « soumises à la guerre comme elles pouvaient l’être, à cette époque, à l’autorité absolue des hommes ».
En haut du village, ses grands-parents, sa mère, son frère et lui occupaient un petit appartement au premier étage d’une maison, au-dessus d’une remise. Une photo de l’été 1943 rappelle la moisson à l’ancienne, les gerbes de blé prises à pleines mains et données au paysan « qui les lie en faisceaux et les place debout dans le champ », des gestes « hors du temps ». Il vivait là sans le savoir « les derniers instants de la civilisation agricole » d’avant les machines.
La faim, Le Clézio l’a vécue « de l’intérieur », ce n’est que d’elle qu’il se souvient : « un vide, au centre de mon corps, tout le temps, à chaque instant, un vide que rien ne peut combler, que rien ne peut rassasier ». « Etre né dans une guerre, c’est être témoin malgré soi, un témoin inconscient, à la fois proche et lointain, non pas indifférent mais différent, comme pourrait l’être un oiseau, ou un arbre. On était là, on a vécu cela, mais ça n’a pris de sens que par ce qu’on a appris par les autres, plus tard (trop tard ?). »
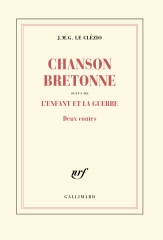 « Cette sauvagerie, j’aimerais mieux dire cette étrangeté, je l’ai ressentie un jour, près de Penmarc’h, en découvrant au milieu de la lande une large pierre plate, pareille à un bateau de granite, recouverte par des lignes géométriques, tel un message mystérieux laissé par les hommes de la préhistoire. Puis j’ai compris que c’était simplement un site de polissage d’outils de pierre. Les outils et les hommes ont disparu, mais la pierre à polir est restée enchâssée dans son écrin d’ajoncs, dans l’état où les usagers l’ont laissée il y a dix mille ans. Cette impression d’un temps immuable, où les siècles se touchent, où on peut toucher le temps avec ses doigts. »
« Cette sauvagerie, j’aimerais mieux dire cette étrangeté, je l’ai ressentie un jour, près de Penmarc’h, en découvrant au milieu de la lande une large pierre plate, pareille à un bateau de granite, recouverte par des lignes géométriques, tel un message mystérieux laissé par les hommes de la préhistoire. Puis j’ai compris que c’était simplement un site de polissage d’outils de pierre. Les outils et les hommes ont disparu, mais la pierre à polir est restée enchâssée dans son écrin d’ajoncs, dans l’état où les usagers l’ont laissée il y a dix mille ans. Cette impression d’un temps immuable, où les siècles se touchent, où on peut toucher le temps avec ses doigts. »